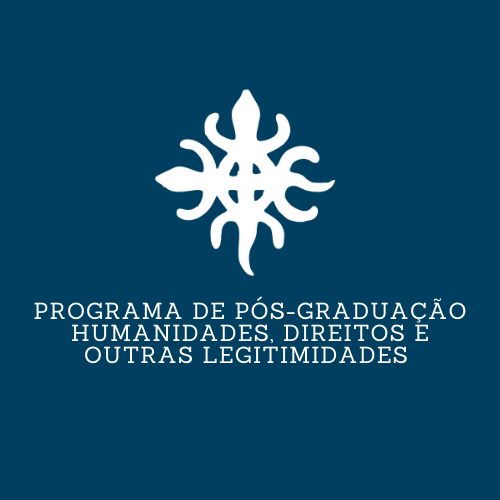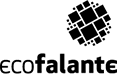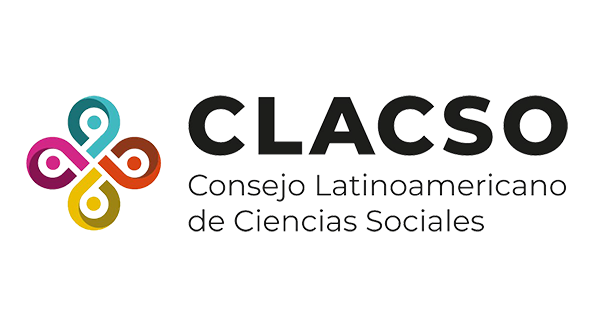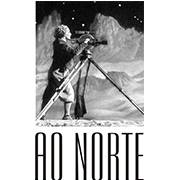Prelude à la Tolerance: Menahem Meiri (1249-1316)
Gerárd Nahon
Menahem ben Salomon ha-Meiri dit Messen Vidal Salomon vécut dans la communauté juive de Perpignan (Pyrénées-Orientales), alors sous la souveraineté du royaume d'Aragon, de Catalogne et de Majorque. Dans le conflit intérieur au judaïsme languedocien et catalan opposant partisans et adversaires des études philosophiques de 1303 à 1306, il défendit les premiers. Le 20 juillet 1306, Philippe IV le Bel expulsait les juifs du royaume de France et s'appropriait leurs biens. Le commentaire monumental du Talmud du Meiri intitulé Bet-ha-Behira, Maison d'élection (cf. Sanhedrin 20 b) écrit entre 1287 et 1300 resta pratiquement inédit jusqu'au XXe siècle. Le 12 janvier 1204 le maire de Perpignan inaugurait sur le site du call, le quartier juif médiéval, un Espace Menahem ben Salomon ha-Meiri et dévoilait une plaque comprenant cette phrase : «Après Rashi de Troyes et Maïmonide de Cordoue, il est aujourd'hui mondialement cité comme le pionnier de la tolérance religieuse dans la tradition judaïque et ses idées fécondent le débat interreligieux du début de ce troisième millénaire entre juifs, chrétiens et musulmans.» Ma communication se propose de développer l'aspect pionnier de l'œuvre du Méiri en matière de tolérance.
Menahem ben Salomon ha-Meiri commente les textes du Talmud restreignant les contacts économiques, voire amicaux des juifs avec les idolâtres, et ceci en vue de les préserver de l'idolâtrie d'une part, d'amener les idolâtres à renoncer à l'idolâtrie d'autre part. Par exemple le Talmud interdit toute transaction commerciale avec un idolâtre trois jours avant leurs fêtes, de peur qu'il rende grâce à son idole pour le profit ainsi réalisé. Le Meiri déclare - et son propos implique la notion de progrès - que l'idolâtrie a disparu en ce temps et dans ces pays. En conséquence ces restrictions ont perdu toute validité à l'égard des non juifs [chrétiens et musulmans]. Certes Maïmonide et les rabbins français du XIIe et du XIIIe siècle dits tossaphistes prescrivaient déjà de se conduire ainsi à l'égard des non juifs, afin de préserver avec eux de bonnes relations, par pur pragmatisme. Le Meiri établit une norme fondée sur le concept inédit des ‘Umot ha-gedurot be-darke ha-datot, nations retenues par les voies des religions, un concept qui se substitue à celui de nations païennes dépourvues de lois religieuses. Dans la vie quotidienne comme sur le plan moral, il convient donc de placer de plein droit les non-juifs sur le même plan que les juifs. Par là, le Meiri rejoint et dépasse la simple tolérance qui supporte ce qui ne peut être éliminé.
Le concept conduit-il à une authentique et pleine tolérance de l'autre dans sa différence, telle que nous l'entendons au XXIe siècle ? Sans le dire, la tolérance du Méiri ne s'applique qu'aux monothéistes chrétiens et musulmans, rejetant les nations vivant à l'extérieur de leurs aires respectives. Cette tolérance - conditionnelle - n'accepte que les nations pourvues de législations religieuses. John Locke, l'apôtre de la tolérance moderne refusera de même la tolérance à « ceux qui nient l'existence de Dieu » (The second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, Ed. J.-W. Gough, Oxford 1946, p. 156). Quelle est par ailleurs la position du Méiri sur la croyance, l'hérésie, l'apostasie, l'incroyance ? La Croisade des Albigeois (1208-1209), une génération seulement avant la naissance du Méiri, avait entraîné des massacres au nom de l'exclusivité d'une croyance dans la chrétienté. « Si on entend par tolérance la reconnaissance de la validité d'une pluralité de points de vue sur la réalité ou la vérité, on n'en trouvera guère au Moyen Age » (Jean-Luc Solère). Dans ce contexte, l'attitude positive du Méiri innove : elle introduit une tolérance positive, certes limitée, mais impensable pour la mentalité médiévale.
Simple prélude à la tolérance, la position du Méiri reconnaissant une dignité à la différence pourvu qu'elle soit régie par une loi religieuse serait-elle aujourd'hui dépassée par la tolérance universelle ? Cependant des phénomènes comme le terrorisme, la violence faite aux femmes, le fondamentalisme religieux ou non, mettent en question la tolérance universelle d'aujourd'hui. Dans la France tolérante et laïque, l'expression d'une opinion négationniste [de la Shoa] est un délit puni par la loi. Face à la devise de mai 1968 « il est interdit d'interdire » prônant une tolérance illimitée, le concept de Umot gedurot, nations retenues [entre des parapets] par des lois d'essence religieuse, mérite d'être défini, étendu et délimité, pour faire de la tolérance un concept entièrement valide et applicable au monde qui est le nôtre, de toutes les exigences, de tous les excès, de tous les droits.
* Directeur d'Etudes honoraire à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne), Section des Sciences religieuses, Membre associé du Laboratoire Nouvelle Gallia Judaica UMR 8584 Centre National de la Recherche Scientifique, Montpellier ; Doctorat d'Histoire, Université de Paris X, 1969; Diplôme de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section des Sciences religieuses, 1976 ; Professeur de lycée 1955-1965. Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, 1965-1978. Directeur d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes( Sorbonne), Section des Sciences religieuses (1977-2000). Directeur de l'UPR « Nouvelle Gallia Judaica » du CNRS. Directeur de la Revue des Etudes Juives. ( l980-1997) et de la “ Collection de la Revue des Etudes juives ”( 45 volumes parus à ce jour). Principaux ouvrages : Menasseh ben Israël, Espérance d'Israël. Introduction, traduction et notes ( en collaboration avec Henry Méchoulan). Paris, 1979; trad. anglaise, Oxford University Press 1987; trad. espagnole, Madrid 1987. Les “ Nations ” juives portugaises du Sud-Ouest de la France ( 1684-1791) Documents. Paris, 1981. Inscriptions hébraïques et juives de France médiévale. Paris 1986 (couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres). Métropoles et périphéries sefarades d'Occident. Kairouan, Amsterdam, Bayonne, Bordeaux, Jérusalem, Paris 1993 ; Mémorial I.-S. Révah. Etudes sur le marranisme, l’hétérodoxie juive et Spinoza, Paris-Louvain, 2001 ; Juifs et Judaïsme à Bordeaux, Bordeaux 2003.